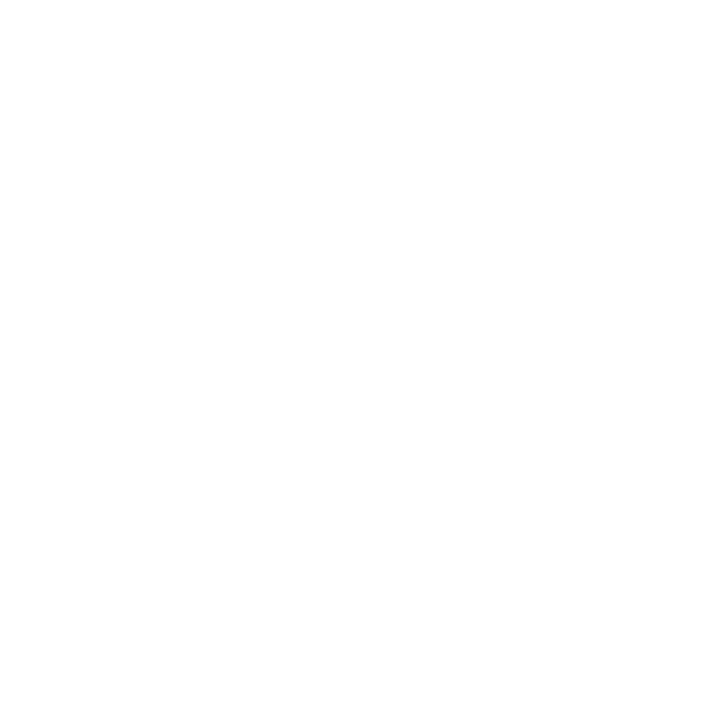Peindre
Il n’y a plus. Plus que la nuit pour la démasquer. Et ça frise dans sa tête dès le crépuscule. Elle attend tout le jour derrière sa fenêtre, à guetter le point de bascule entre les bleus mourants et les rouges coupe-gorge. Il n’y a plus. Plus que la nuit pour l’apaiser : c’est le gris puis le noir qui donnent au regard le vide qui lui plait. Elle et ses rêves éveillés fixés sur l’horizon qui disparaît. Seule et débarrassée des encombres du jour, des couleurs trop violentes qui côtoient ses pensées, des traits trop emportés qui taisent son visage.
Il n’y a plus. Plus que le mordant des vêpres qui sonnent au loin pour croquer l’espoir : la vie qui ralentit au moins quelques heures pour un entracte à la frénésie du jour. Un répit salvateur qu’elle peint de couleurs chair, un pastel éthéré qui colle à son corps. Du bout de ses pinceaux diurnes, elle cherchera les nuits sauves et au plus tendu des ombres, quand le silence lui biffera l’esprit, elle glissera dans sa peau, légère et enjouée. Tomberont alors les trop-pleins et les masques, les rides accumulées comme voilées par l’obscurité et les salissures du jour disparues en pluie revigorante.
Il n’y aura plus. Et elle sourira, peut-être.
Calme plein
Oreille collée à la plage, j’écoute le bruit des galets, c’est sourd et puissant, comme un bruissement qui se confond avec le dedans, à ne plus savoir ce que j’entends : mon corps bout et son ébullition remonte en geyser à mon oreille ou bien est-ce un récital souterrain sous le sable, un de ces concerts au creux des coquillages, une couleur chassant l’autre, blanc et noir accordés comme un clavier géant. Une alliance des deux, sûrement. Une seule voix murmure, un son continu remplit ma tête, aère l’intérieur, dépoussière neurones et contacts vrillés. Une seule ligne traverse le tympan, sans mélodie mais en harmonie avec le décor. C’est un mesclun frais de notes étouffées et d’acouphènes crâniens marinés en agapes. Et la paix autour prend son pied. Je suis seul dans ce lieu si agréable à l’apprécier, c’est étrange. L’autre oreille en suspension dans le vide n’entend même plus le cri des mouettes ni le ressac, ni aucune vague déferlante, pas plus que l’écume qui joue. C’est le calme plein, une huile sur mon rivage.
Le printemps des ruelles
Il attrape le temps, comme il peut, bouffée après bouffée. Il se taille des routes, passe par des voies étroites, des ruelles sales où souffrent ses poumons d’exister. Une taffe, juste une taffe et il se consume dans son costume.
Dans sa vie, cet arpent sans filtre et lui, au milieu, nu comme un vers de grand poète qu’il s’éreinte à débiter en volutes suaves et malignes. Parfois, bouche en cul de poule, il flirte avec le rond parfait, celui qu’on veut éclater avec le doigt et qui disparaît trop vite mordu par un frémissement d’air. A l’étroit, toujours, engorgé dans des ruelles sombres au goudron gluant et mortel poison, il inspire des possibles, des terres plus grandes, des avenues claires et, rêve fou, des grands boulevards dépollués avec au bout, luisante, la mer calme et transparente.
Mais entre deux tentatives, il crache, expire et taffe encore. Une pression maximale sur les dents, la gorge nouée et les lèvres suceuses de l’enfer et c’est la toux qui gémit, tapie dans l’ombre d’une basse cave au plus étroit de la plus noire des ruelles. Quinte flush assurée sur le pavé. Ça rue dans les bas-fonds, ça secoue les volets, ébranle les valvules jusqu’à décrocher les vieux linteaux et le voilà à sniffer la mort dans la rigole, le poitrail à feu et à sang. Au printemps des ruelles.
La chambre oubliée
C’est par quelques trous que le jour entre. Au travers des vieux volets vermoulus rabattus en clé sur la chambre. Par le vieux bois aux interstices bedonnants, la lumière se fraye un chemin, une lumière refoulée et grise à cause de la réverbération du mur d’en face laissé à l’état brut. Le ciment grossier qui le patine avale la lumière pour la recracher comme mâchonnée de tristesse.
C’est là que le temps passe à deviner dans les nuances de gris la couleur du jour. Les lignes souriantes, celles des après-midi les plus clairs, enduisent la pièce d’une gaieté frelatée. Chaque rai de soleil gonflé par l’envie de luire tape le lit pour rebondir sur la tapisserie à fleurs fanées et finir sa course, piégé par excès d’orgueil, au creux de la grande armoire vide. Les anonymes, les réguliers, ceux que l’on devine dès leur entrée comme des gris insipides se prennent les pieds dans la poussière et disparaissent en fumée avant même d’avoir dégagé une quelconque clarté. Seul le noir des plus gros nuages arrive à percer la fenêtre pour napper un peu plus de pénombre la chambre oubliée.
C’est là que la vie se trempe dans les ténèbres, pièce réceptacle à solitude et turpitudes. Tout est rassemblé pour broyer le gris, seul admis à passer la fenêtre. Il y fait bon enliser tout cafard boiteux qui n’arrive pas à se dissoudre dans la lumière vive du dehors. C’est là la chambre oubliée, celle qu’on a délaissée parce qu’inusitée. La chambre du petit qui est parti.