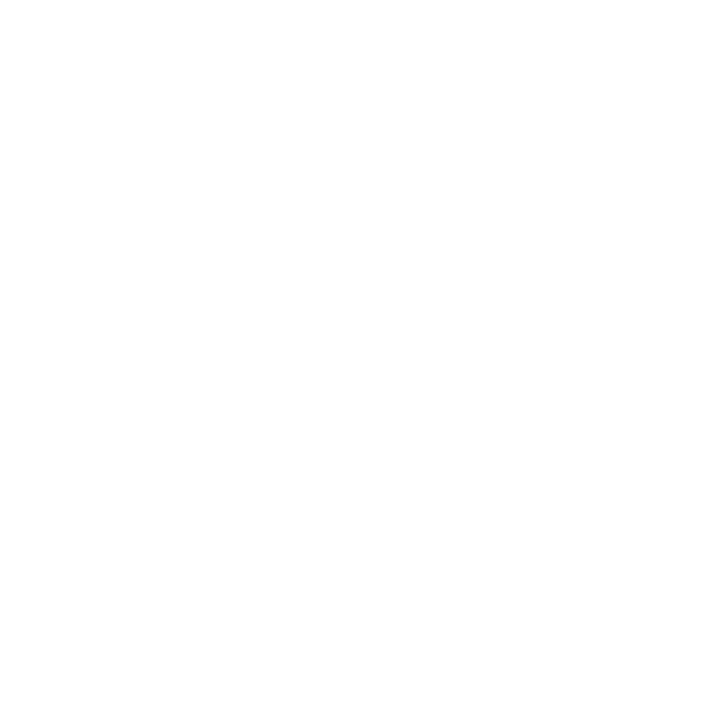- 1 -
« 3 Novembre.
Nuit à peu près calme. L’heure du retour approche. Angoisses. Hier, la ville a fait semblant d’être triste. »
New- York. Oui. J’étais bien à New-York quand c’est arrivé. Je menais une vie solitaire et je crois que la raison à ce choix de vivre, non pas recluse, à l’écart de tout, mais seule avec soi-même et libre, surtout, libre d’avoir le monde entier pour me tenir compagnie et ça seulement quand j’en aurais envie, la raison à ce choix délibéré et têtu, c’est que j’avais lu quelque part, ou alors entendu quelqu’un dire, que c’était l’ennui et la peur, l’ennui de vivre et la peur de mourir qui jetaient tout à coup les gens hors de leur chambre et les précipitaient les uns contre les autres, pour parler, s’interposer, plaindre le vide, meubler le silence, couvrir de bruits assourdissants ces sanglots qu’on ne parvient plus à étrangler quand le jour baisse. Oui. J’étais bien à New-York. Voilà. Peu à peu, les choses me reviennent. Je menais une vie solitaire. Il me semble que j’étais heureuse de mener ce genre de vie-là, dans ce genre de ville-là. Il est clair que j’étais encore assez naïve. Le genre, bien sûr, ça n’existe pas. Je suppose qu’il ne reste plus aucune trace de la vie que je pouvais mener à New-York à cette époque-là. Au fond quelle importance.
Revenir jusqu’ici, j’ai fait ça sans réfléchir. J’étais assise au milieu d’un jardin pelé comme une vieille chienne. Et à part ça du vent. De la tristesse. Et cette envie qui revient vous gratter la tête. Et puis je me revois soudain grimper à l’arrière de ce camion. J’étais peut-être saoule. Groggy. Sonnée. Mais ce camion me ressemblait et à nouveau j’ai eu confiance. Ce camion était comme moi, gris de la poussière des routes. Et puis on a roulé. J’ai dormi. Et puis le ciel de New-York s’est mis à me peser sur le crane comme le couvercle gris-fer d’un jour sans soleil. A quel moment me suis-je réveillée au milieu de cette séquence urbaine ? Depuis quand suis-je à marcher dans cette ville où mes souvenirs ont sans doute commencé à pourrir ? Est-ce pour leur échapper, eux et leur odeur de pourri, que je baisse la tête ? New-York. Voilà. Ce ne sont pas les mensonges et les tricheries qui partent dans toutes les directions. Seulement des taxis et des voitures de police. Il n’y a aucun mirador. Aucune forteresse menaçante. Justes des édifices bancaires tenus au secret et des Palaces en plastique fondus au noir. J’ai rejoint le trottoir de l’ombre. Le flou a fait place nette. Je remonte le cours des évènements.
- 6 -
« Dimanche.
Un dimanche où c’est soudain devenu plus facile de venir à bout des opinions. »
Déclic ? Révélation ? Quoi d’autre ? Je ne connais pas le nom exact que l’on donne à ça, mais j’aime. J’aime surtout l’effet immédiat – la chose inédite — le sentiment nouveau, tout ça qui se cache juste derrière le nom, tout ça, ces trois trucs, couplet-contrepoint-refrain, ces trois trucs qui tour à tour se reniflent, s’associent puis finalement se repoussent, ce déclic — cette révélation — cet on ne sait quoi, tapis dans son trou de bête, ou alors en arrêt — les muscles figés nets, comme un chien au pied de la lettre, et quelque fois, aussi, embusqué à l’abri de la dernière syllabe, tout ça attendant que le gros de la troupe à vue d’œil s’amenuise et tant pis les heures que ça prendra, tant pis le temps que ça va mettre. Tant pis. Tant pis. Le sens, depuis qu’avec le jour qui baisse des mains obscures poussent leurs drôles de pierres afin de fortifier les derniers bastions de la nuit, le sens, par-dessus tout, ça sait attendre. C’est un animal craintif, le sens. C’est cet animal qui a coutume de sortir de l’ombre une fois dissipées une par une les dernières impatiences.
- 12 -
« Une autre partie du monde. Deux sortes d’hommes peuplent cette partie-là du monde.
Ceux qui se demandent encore pourquoi. Ceux qui répondent toujours parce que. »
- On m’a dit de m’adresser à vous, Monsieur. Vous comprenez. Que vous étiez même la seule personne capable de me renseigner. Monsieur ?
- Qui vous l’a dit ? Ne voyez-vous pas que nous sommes seuls, ici. Oui. Tout seul. Et puis vous renseigner à propos de quoi, d’abord ?
- Et bien à propos de cette autoroute. Où conduit-t-elle, pour commencer ?
- Dans ce cas la fin est le commencement. Cette autoroute, c’est terminé. Elle est au bout de la ligne, vous comprenez, cette autoroute. Elle ne mène à rien. Nous sommes au milieu d’un grand nulle part.
- Enfin, Monsieur…C’est assez dur à croire… surtout qu’elle n’a pas l’air habituel des choses qui ne servent plus.
- C’est parce qu’on me paye pour la maintenir en état. C’est tout. L’entretenir juste ce qu’il faut, le temps qu’il faut. Pour les visites, enfin vous savez bien. Quand il y en a.
– Des visites ? Beaucoup ?
– Vous êtes le premier visiteur depuis six mois.
– Et depuis quand ça se visite, les autoroutes ?
– Pas les autoroutes. Cette autoroute.
– Et qu’est-ce qu’elle a de tellement remarquable ?
– Il y a bien des années de cela, c’était même il y a fort-fort longtemps, à l’époque où les gens se sont mis à construire des autoroutes pour faciliter l’invasion de leurs voisins, il y avait deux églises – deux grands partis – deux courants de pensées, deux blocs tellement opposés qu’ils en sont venus à se faire une guerre sans merci. Ah oui, dernière chose. Cette autoroute servait de frontière entre les deux blocs. Et sachez que deux immenses fosses communes, deux fosses communes de près de 400 km chacune, longent cette autoroute, mon autoroute.
Texte – Benoit Jeantet
Acrylique + encre de chine + glacis sur papier, Catherine Arbassette
Un dossier complet de ce travail est visible sur le site de Catherine Arbassette