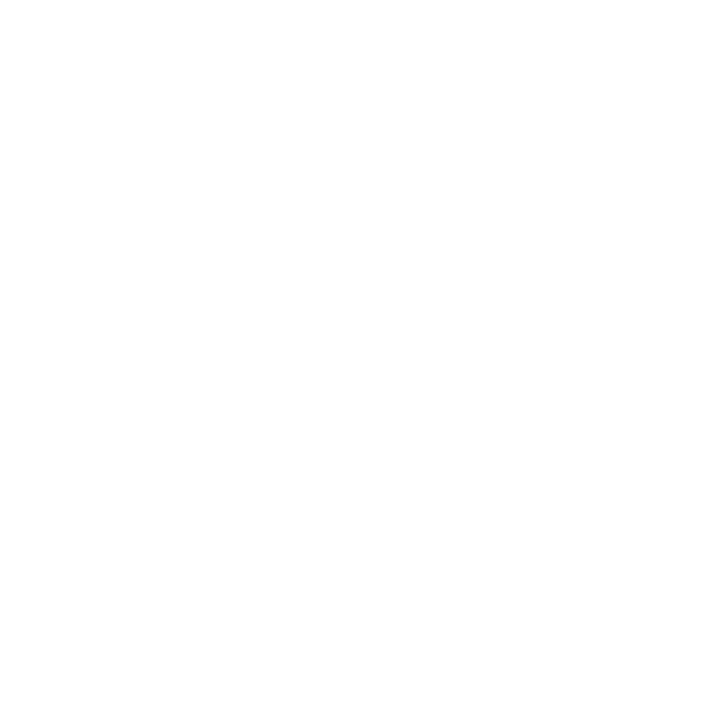Pendant la mousson
Au-delà de la peau existent d’autres sensations
L’été en poussières et l’automne chétif.
Où sont les mains, les bras, les silences…
Une année glisse sur les rails du Sky train et
Des visages d’anges perturbent le paysage.
À peine le temps de naître et de rêver…
Un typhon s’incruste en nous puis se noie,
Chargé d’odeurs qui éveillent l’instinct d’océan.
Souplesse
C’est comme une danse qui s’agite en nous
avec dans nos poches quelques pages
Et sous l’œil sculpté à travers le monde
Une ombre à peau pierre
Rimbaud au fond d’une sablière
C’est comme une portière qui claque dans un cœur
Et sur mon corps élastique rose
Mille à l’heure dans le soir ouvrant boutique
Ses lampions éphémères, trous de lumières
Phares par dizaines qui rentrent sous terre dans les abris
C’est comme un volant fou qui nous conduit
Une danse en nous qui m’allonge élastique rose
Jusqu’à toucher le rêve déplié
À mille à l’heure allongée… étirée
Je serre les dents et le cœur pour ne pas claquer
Et si je claque tant pis j’ai connu la vie en rose.
La ville est tranquille
« D’anciennes voix qui crient autour »
Federico Garcia Lorca
Rêver la tiédeur des faïences
Sous une morsure de soleil
Sentir la force d’un chat
Repliée à l’orée des corps
Consulter la nuit dans l’œil du village
Ses murs peints à la chaux
Et ses sortilèges de tissus agités
Sur la corde à linge un dimanche.
S’étirer à la fenêtre sur le toit
Regard plongeant dans un décolleté de château
Et engager sa mémoire
Sur la ligne de crêtes de la Sierra.
S’étirer en pensant à la saveur
Oubliée au fond d’une tasse
Au poème de Lorca
Sur un bord de fontaine Azul
Le soir, une odeur de froid
Quand on ne l’attend pas
Aide à incendier l’œil de la nuit
Dans une bougie.
Quand tout est consumé
Quand la ville est tranquille
Chercher à tâtons
Moissonner dans le noir
L’histoire qui perfore la peau,
Malaxe chairs et obscurs
Puis vient se loger dans le cœur
Une balle
On meurt.
Rio Vero
Chaleur encore jeune. Pierres en habit de lumière. Sentier qui dévale dans des gorges où le figuier colonise les bancs de terre… Friches d’été aux fruits mûrs de ronciers. Roches qui se répondent de paroi en paroi et de souvenirs en avenirs. Houx sauvages, micocouliers, terre engrossée à l’odeur d’eau brûlée. Puis soudain, une grille en fer au dessus du vide de l’eau bleue, verte et transparente…
Sous le silence assourdissant du soleil, nos désirs d’abandon vont en nage dans le Rio. 13 heures et la marche reprend. Un vieil homme pousse sa brouette vers la fontaine. Il salue et serre la main des Français. Dans sa paume, la fraîcheur troglodyte d’une maison de roches.
Carnaval et paprika
Le Port. La Joliette… Des avenues trempées comme des linges insensés. La pluie fait des entailles aux sourires. Sur les pavés claquent les traces de talons et le miroir des vitrines enlace nos images qui glissaient, passaient, se délitaient puis succombaient dans un mouvement d’ensemble qui nous emmenait où… Est-ce que tu sais. Je ne sais rien, je cherche. Le visage maquillé d’ombres pour le carnaval de San Zaccaria. Marseille et les bateaux se sont éloignés, des milliers de kilomètres se sont engouffrés entre deux silhouettes séparées. Vent, nuages, terre. Maintenant, l’île s’habille d’humeurs aux balcons, de lanternes rouges d’une maison de Chine.
Je marche vite, en souvenir des trains, des taxis, des navettes, des halls d’embarquement. Je respire, j’exulte. Quelque chose de chaud, mais plus fort que le sang, circule dans mes veines. C’est une musique ancienne qui se joue de nous et autour, la ville s’allonge, se découvre jusqu’au fond des alcôves enfumées.
Marseille et ses bateaux reviennent, chargés des épices de la mémoire. Le port, la Joliette… Droit devant, un bus fait son ramassage des existences désaffectées. Des visages inconnus, collés à la vitre, m’observent puis s’éloignent, dans un roulement de tambour des roues sur la chaussée. Ce qui reste… Je ne sais pas vraiment, mais je cherche.