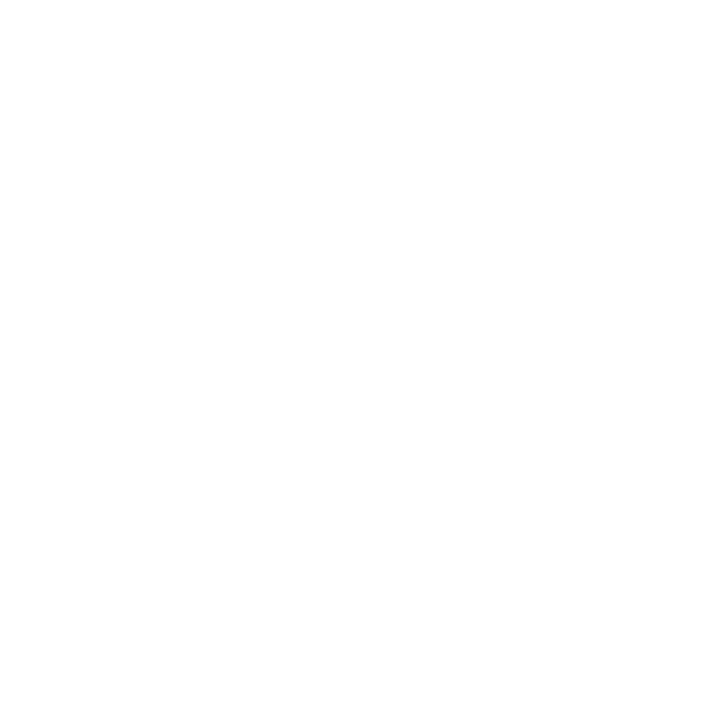Marilyse
Tout ce que nous nous disons aujourd’hui, tout ce que nous écrivons, nous le savions déjà, intuitivement, depuis le début. Notre œil avait vu mais il a choisi ses voiles. Notre oreille avait entendu mais elle a choisi ses silences. Il faut bien vivre et survivre à ce qui n’est pas nous. Comment faire autrement ?
Marie-Josée
Tout remonte en moi à mesure que nous parlons/écrivons. Quel dommage que nous n’ayons pas conservé tous nos instantanés, ces milliers de paroles dont certaines valaient des pépites…
Que ferons-nous de tout le reste ?
[…]
Marilyse
Ce qui reste ? Peu importe ce qui est perdu, rien ne l’est vraiment, puisque, en poésie, nous sommes dans la vérité d’une parole qui avance et nous dépasse, tout en étant profondément ancrée en nous.
Marie-Josée
Construisons donc… Reprenons le fil…
Marilyse
Avançons. Ce sera une aventure de vie dans les mots partagés… Créons entre eux, entre nous, une distance, un chemin à parcourir dans nos labyrinthes respectifs, intérieurs et extérieurs. Gardons un écart entre alter et ego. Déjà chacune de nous contient son propre écart. Cet espace interne, faut-il le réduire ? Le supprimer ? Ou le laisser aller à sa guise ? Élastique à tendre ou à détendre. Si on resserre tout, plus rien ne passe, aucun flux, aucun afflux. Cultivons l’écart.
A l’écart
par les chemins
de traverse
Un pied toujours
en-dehors de soi.
(in Herbes, Donner à voir, 1995)
Marie-Josée
Dans cet écart, la langue doit frapper, donner des coups de poing, intercaler la souffrance et le dire. Dans la promesse des mots dès l’enfance, ces mots qui étaient déjà là, quoi en faire ? Où les prendre ? Ce n’est pas un donné d’avance mais on croit dans ce possible. Je me souviens d’Heather Dohollau que tu aimes tant… « La promesse des mots, c’est la promesse d’un possible des mots »… « Dans le besoin de livres qui a été là extrêmement tôt, les livres me rassuraient », dit-elle, une façon de guérir de cette obsession du temps qui passe. La poésie est une façon de garder quelque chose de ce qu’on perd.
Marilyse
Tu dois faire tienne cette phrase de Kafka : « Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous ; voilà ce que je crois. » 1
[…]
Marie-Josée
Je suis née révoltée dans une famille dont les origines portaient déjà la colère. J’ai dû faire avec ce bagage et un autre plus discret, étouffé. Je ne savais pas exprimer cette colère, j’ai essayé de l’écrire. Elle n’est pas plus parvenue à se dire. Au bout du compte, l’épuisement psychique a eu gain de cause. À tous ceux qui s’épuisent dans des luttes vaines, il n’est pas inutile de les prévenir. Point besoin d’apocalypse. Notre fuite en avant nous y amène tôt ou tard. Vaincus par notre vanité à croire qu’il nous faut toujours nous battre, certains ne défendant au passage que leur pré-carré. Nos prérogatives d’humains atrophiés ou privés de liberté se heurtent au mur de l’indifférence et du plus grand nombre. Tant qu’il y a de la vie, on pense : il faut résister. Mais résister à quoi ? Les luttes épuisent plus sûrement. Nous passons tous par là, l’un après l’autre. Et un jour, nous nous retrouvons assis sur un banc à regarder passer les nuages, le bruit lentement s’efface, et plus rien alors n’a d’importance.
[…]
Marilyse
Ariane, si contrainte qu’elle puisse être, a droit, elle aussi, à son odyssée. Sa toile est son sillage, toutes les traces qu’elle a laissées, qu’elle a emportées vers la haute mer en constituent la trame. Nul besoin de mains autres, sinon celles qui ont tissé ses jours, qui les ont cousus à sa peau… Dans cette aventure qui nous est commune, nous ne savons qu’une chose : nous ne savons pas ce que nous écrivons. Tout est fragile, ouvert. Le rien s’ouvre sur le tout et revient au rien, pulsation qui nous tient en éveil au bord de la nuit, toujours, funambules d’un fil qui de nous-mêmes procède, pour paraphraser Saint-John Perse, cet « allié substantiel » qui m’accompagne depuis mes 19 ans. Bénis soient les poètes qui nous font naître, qui nous font vivre, chacun d’eux, chacune d’elles.
Quelque chose veille
entre seuil et sommeil
Un trait de lumière parfois
en donne la distance
Si peu dans la nuit
Rien qui ne puisse passer
comme un courant d’air
sous la porte.
(inédit 2014)
Marie-Josée
Le désir de vie… pendant des années, j’ai senti sa brûlure en moi. Ce n’était pas la première fois, ça ne serait pas la dernière. Une fièvre plutôt qu’une brûlure… mais n’est-ce pas la même chose ? Il m’avait laissé ce feu qui, piégé dans les rets de mon âme, brûlait depuis longtemps. Sous les braises qui couvaient déjà et s’étaient ranimées, l’ardeur d’une vie à accomplir était vivace. En une nuit, une seule, avec un autre, le même (?) tout fut consumé. Le corps dévasté, de l’intérieur, l’épuisement fit son œuvre, ne restait que des semblants, des faux-semblants. Ma verticalité faisait illusion. Un temps seulement. Après le cœur, la gorge, le ventre, les muscles s’immolèrent. La douleur s’installa dans tout ce qui restait, le squelette, la peau. Me força à m’allonger, quand tout me contraignait à rester debout. La lutte était injuste, impossible à tenir.
Marilyse
« L’étoile augmente les étoiles »2, a écrit Éluard. Sommes-nous des étoiles dans nos chaussons de peu ? Chairs blessées, fragiles, griffes et dents sous les boucles ?
Marie-Josée
Oui… Tel Job sur son lit de fortune, je suppliai qu’on m’aidât à mourir mais la camarde, occupée autre part, m’obligeait à regarder vers cet ailleurs pulvérisé. À vouloir vivre debout, je n’en finissais pas de m’oublier. À donner toujours plus dans le vent, à soutenir l’espace de mes gestes inutiles et fragiles. Son feu m’avait brûlée et je serais redevable à jamais… d’une dette inconnue. J’avais pris perpète. Durant toutes ces années de fièvre, aucun médicament ne vint soulager la douleur, trop ancienne sans doute, faite de tant de meurtrissures, une plaie jamais refermée. Comme un virus inguérissable, une fièvre puerpérale, indétectable mais pugnace, les symptômes de cette fièvre, aggravés par l’angoisse envahissante exigeaient une lutte de chaque instant pour ne pas sombrer dans la folie.
[…]
Marilyse
Il me plaît d’imaginer l’écriture comme un univers en expansion, je souhaite te dire que j’aime ton écriture pulsatile : « J’avais pris perpète » après des phrases plus longues et d’une autre envolée, bravo ! Ton écriture dit le mouvement de la vie, elle l’accompagne, le recrée, le prolonge. Écrire n’est pas une activité extérieure, c’est notre respiration profonde, notre adhésion à la vie, la preuve irréfutable de cette adhésion. L’écriture est du sang tissé.
Marie-Josée
Oui je le crois, écrire est une activité du dedans. Un lent travail de forage, de descente à l’intérieur de soi. J’ai toujours senti dans cette descente la même quête spirituelle du sens. En ce qui me concerne, dans les renoncements, commencés très tôt, d’abord comme une nécessité de s’appauvrir, de se dépouiller, ensuite comme une réalité. Plus je m’appauvrissais matériellement, plus je m’élevais spirituellement. Lorsque cela arrive, on se défait des derniers oripeaux de l’orgueil, on déshabille son âme et on apprend l’abandon.
Longtemps j’ai adhéré à cette phrase de Pessoa : « J’enrage. Je voudrais tout comprendre, tout savoir, tout accomplir, tout dire, tout jouir, tout souffrir, oui tout souffrir. Mais rien de cela, rien, rien. Je reste anéanti par l’idée de ce que je voudrais avoir, pouvoir, sentir. Ma vie est un rêve immense ». Et un jour, j’ai compris que la vie consiste à s’abandonner, à ne plus résister. Vouloir tout maîtriser, vouloir être maître de la connaissance, de ses désirs, de son vouloir, tout cela ne conduit qu’à la souffrance. Il a fallu la mort de mon père pour m’en convaincre et me ramener à lui, à sa vie de labeur, de souffrance et de recherche d’une seule vérité : l’amour.
[…]
Marilyse
Nous sommes des mères par essence, des « matrices d’idées » comme dit Merleau-Ponty. Tout autant que des filles. Tout autant que des ballons volants. Ne cédons pas, comme l’écrivait René Char, le moindre de nos « graviers d’eau ». Ne nous laissons pas mutiler d’une part de nous-mêmes. Existons, vivons, pleinement. Différemment.
[…]
Marilyse
Des couleurs que nous aimions, tous les rayons étaient nécessaires, comme, sur le prisme des roues enfantines, ces teintes qui n’éclatent que placées les unes à côté des autres. La vie est éclat, nuance, valeur nuancée, lumière qui tourne. L’amour qui nous porte est un prisme qui doit donner à voir toutes les facettes de la vie dans leur unicité et leur harmonie, ombres et lumières mêlées. Chaque jour, nous apprenons à vivre, à aimer. Sinon, à quoi bon ?
Marie-Josée
« la nuit éteint les couleurs,
celles de l’âme demeurent un ciel serein toujours
ouvre tes mains
pousse ce cri sauvage qui t’emplit »
(Blue note… pour un hêtre, inédit)
Cultivons la joie, c’est tout ce qui nous reste. Renoncer à l’écriture, impossible ! Malgré le désastre, malgré l’illusion, cultiver la joie, la déposer si possible sur chacun de nos mots (maux) comme un baume salvateur.
Marilyse
Oui, la joie, l’allégresse, la lumière, la pleine lucidité. Tout ce qui renaît et nous fait renaître chaque jour. L’insurrection permanente de vivre. Même si nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette exigence. La poésie est pour moi l’expression la plus intime, la plus dense du désir de vivre. C’est de l’énergie vitale à l’état brut qui pulse dans nos veines. Les différentes formes qu’elle prend sont de l’ordre du filtre, unique pour chacun.
« Poésie pour vivre mieux et plus loin », je fais miens ces mots de Saint-John Perse.
Marie-Josée
Décider d’être heureux procède de cette joie que l’on porte enfouie tellement profondément et que l’on se refuse face à un monde chaque jour en désastre. Vivre la joie, c’est être dans chaque minute, comme en poésie, tenter de donner main à ce courage d’être heureux car il s’agit bien d’un courage…
Certains d’entre nous traversent le monde souvent de manière insouciante, se croyant libres ou pire, éternels, oubliant ce qui leur est le plus essentiel, au nom de causes plus vastes, d’un monde à sauver, d’une idée à défendre, se donnant ainsi une importance dont le monde après eux n’aura cure. Ils pensent à leur travail, ont une œuvre à finir (ou à commencer), un combat à mener, ils se croient investis d’une mission, et un jour, découvrent que rien de ce qu’ils ont accompli n’a servi leur vie, ils n’ont été que malheureux, le monde n’a pas bougé de place, on les a même oubliés, et eux ont oublié l’essentiel : la joie.
Tous les grands concepts auxquels ils croyaient se sont révélés précaires, flous, confus, voire pervertis… Rien n’est plus fragile que la liberté, rien n’est plus illusoire que la vérité.
« Le don d’écrire est précisément ce que refuse l’écriture. Celui qui ne sait plus écrire, qui renonce au don qu’il a reçu, dont le langage ne se laisse pas reconnaître, est plus proche de l’inexpérience inéprouvée, l’absence du « propre » qui, même sans être, donne lieu à l’avènement. Qui loue le style, l’originalité du style exalte seulement le moi de l’écrivain qui a refusé de tout abandonner et d’être abandonné de tout. Bientôt, il sera notable ; la notoriété le livre au pouvoir : lui manqueraient l’effacement, la disparition. Ni lire, ni écrire, ni parler, ce n’est pas le mutisme, c’est peut-être le murmure inouï : grondement et silence. » 3
Textes extraits d’un travail en cours: Marie-Josée Desvignes & Marylise Leroux
Encres : Marie-Josée Desvignes
Photographies :
Hélène Desvignes