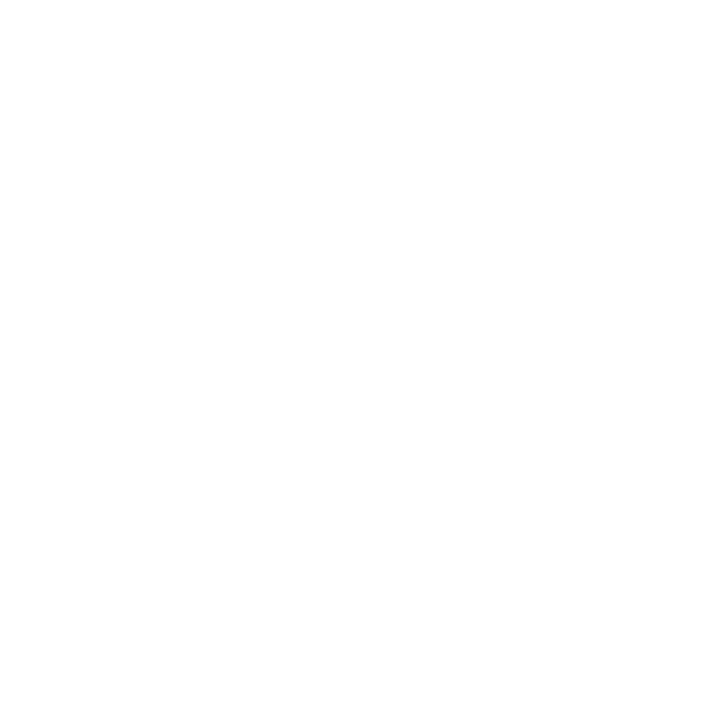casque
découpé à l’emporte-pièce
dans la cagoule anti-feu
le médaillon de tes yeux
elliptique ton regard sous la visière
qu’absorbe le zéro de bitume
parmi des chiffres qui tremblent
les compteurs
le levier
je me souviens d’une photo où tu vivais
tu démarres sur le grand zéro
tu pars
tu reviens dans ton dos
au départ
pilote de rien
pour finir
ton casque jaune sur le meuble
enfilé
héros à ton insu
amplifié le son du souffle
ton nom que j’y criais
résonnant me restait
tu tonds le jardin
tu montes un mur
tu bois ton apéro rare
je suis tout dans ce casque
qui me sépare
mais nous rapproche
je te suis
suis la route
et la route
imaginaire nous défie
réelle nous défait
je suis là
je respire transpire
dans ton casque ta sueur sèche
que je ranime à celle qui me vient
de ce qu’en toi je brûle.
le danseur
d’abord la main noire,
comme taillée dans le cuir
poussiéreux d’un éléphant.
les ongles bombés ont
un jaune de griffe,
et même liserés de crasse
semblent manucurés.
la raie du nez et le front
sont peints en bleu,
comme Pierrot quand il
s’apprête à n’être plus que
la mer perdue au ciel.
les yeux plissés vous percent,
noirs, sans pupilles,
saisissants ou rieurs,
on ne sait,
disent qu’ils ont raison,
que vous avez tort,
ou que vous croyez
qu’ils ont raison
et que vous avez tort.
ils vous lisent.
vous pensez qu’ils vous lisent.
ils ont encore ou déjà
quelque chose au-dedans
qui vous précède ou succède.
cet homme contemporain
serait un aïeul,
s’il n’y avait
contre ses lèvres
une cigarette roulée
dans une page de livre
à la langue étrangère,
s’il n’y avait
cette manière de médaille
à son front
frappée d’un marsupial,
d’une autruche,
d’un Territory of New Guinea.
rose et piments
je suis là pour faire le point.
prendre du recul, comme on dit.
et je suis seul avec la rose d’un ami.
quand je suis arrivé ici il y a cinq jours,
saturé, raidi, perdu,
mais vivant de nouveau,
le cœur battant comme à la guerre,
elle était là, épanouie,
dans son rouge obscène de cérémonie.
ma grande main n’aurait suffi à la tenir.
sa tige plantée dans un vieux bocal de jus d’orange,
buvant à l’eau même où barbotent des piments.
cela la booste, m’as-tu dit, mon ami.
incrédule, j’y ai fourré le nez.
elle était si fière. je l’ai crue factice.
par hasard, un amour ancien a frappé. a beaucoup dit.
qu’il partait loin. elle n’a pas bougé.
les amours en cours, à vie, sont aussi passés,
s’appliquant à mon retour. la rose a tenu.
c’est ce soir, seul, après des jours de portes ouvertes
et refermées, que je remarque qu’elle aussi s’est close.
séchée. transie.
on dirait maintenant un cœur de petite bête
noirci, à l’envers, au bout d’une pique.
je m’en approche.
elle me fait penser : c’est une betterave feuilletée.
les piments tiennent pour de bon.
ils attendent
comme moi.
je me demande : et les pétales ?
et les piments, ce sont eux qui sont faux ?
je suis debout, encore.
héron
le voir d’un coup, comme ça, à la nuit tombée
choque comme une annonciation, un miracle.
trois colonnes de lumière derrière lui tremblent sur l’eau maigre et la vase.
les éclairages glauques du pont sur le bief.
les feux de croisement inextinguibles bruissant au loin.
le corps éthérique du centre commercial, bleuté
déchiré par les couronnes nues du petit bois qui m’abrite.
trois colonnes de lumière trahissent.
dans sa posture verticale, pattes ancrées dans l’eau, le héron attend.
taxidermie, mais le cœur là, tambour battant.
un dieu païen descendu sur terre pour croire. assister à l’homme.
éclair de sang et de plumes piqué dans l’eau douce
et qui toise l’énervement humain,
guettant l’instant propice où le bec entrera dans la rivière et la proie.
entaille d’obscurité et de paix faite à la chair du monde.
et pleine d’orgueil. et pourtant le contraire de l’homme.
nénuphar
ses racines sont enfouies sous une terre noyée.
il traverse une obscurité mince et calme.
d’infimes créatures l’observent ou l’évitent,
le suçotent ou dévorent.
mais c’est tout là-haut,
au rez-de-chaussée de la lumière,
à cette surface à vos pieds,
que se développent
ses vastes feuilles,
et sa fleur sous le plein soleil,
où se reposent d’autres dérisoires créatures,
figées pour un temps.
insectes brillants, anoures discrets,
et vos yeux baissés que ce même soleil use.