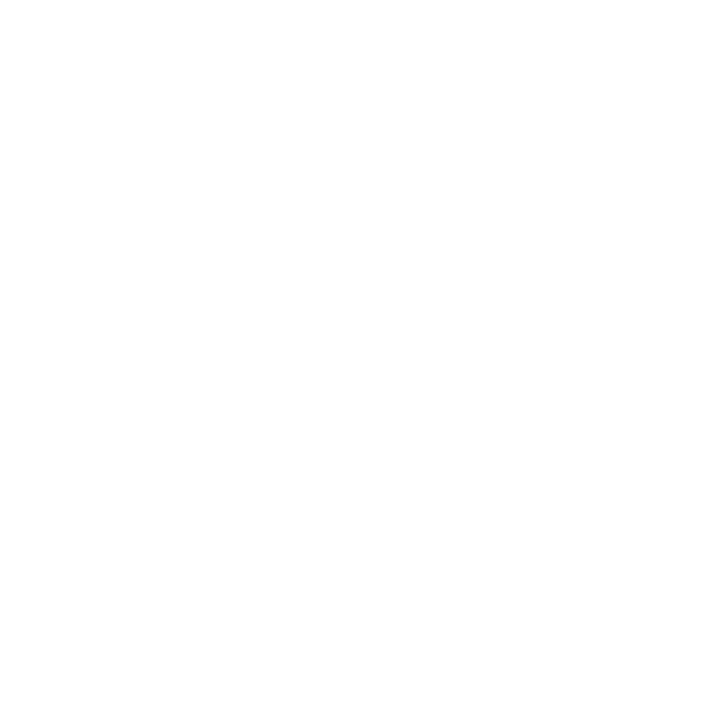Sur la rive
Sur la rive il y a ce vieux couple
Enlacé embrassé comme si
C’était le dernier jour du monde
Si c’était le dernier amour
Et c’est le matin de Paris
Dans la lumière sablée on croise
Des adolescents qui adossent
Leur jeunesse au mur du lycée
Puis sont là deux petits enfants
Et au fond de leurs yeux de miel
Flotte encore un peu de la nuit
Pharaon de haute misère
Et souverain des bas-côtés
Un Sdf dort ratatiné
Dans son sac de couchage
Gris sarcophage d’infortune
S’en fout des tours de Notre-Dame
Qui échafaudent l’horizon
Improbables falaises d’ocre
Que l’océan a délaissées
Pour la caresse des navires
Le ciel sur les toits est blanc et bleu et rose
Et c’est le matin de Paris
Si lourde encore de trop de peine
L’eau se mêle au ventre du fleuve
Long fleuve qui n’est pas le mien
Qui n’est que le grand frère de l’autre
Celui qui coule en mon pays
Au croisement des amoureux
Corps déliés et leurs baisers
Lèvres mêlées pour verrouiller
L’étroit passage de la nuit
J’ai connu Paris mon amour
Aveugle en ce temps j’ai posé
La main sur la peau nue du jour
Quand s’amenuise le désir
Et qu’alors les ailes nous manquent
Prisonniers des murailles de pierre
Les rois si vieux dans leur galerie
Leurs deux yeux vides en pleine face
Suivent l’envol des fiers corbeaux
Ailes feutrées longent l’azur
Ils ont dit-on grande patience
D’attendre ainsi que nous partions
Le sais-tu ce monde est sauvage
Et c’est le matin de Paris
Les feuilles
Les feuilles feront un ciel
Que perceront une à une
Les lames de lumière
Lumière en chute douce d’étoile
Blanche comme une peau
Et qui semble frissonner
Quand s’agacent les saules
Dans le ventre de la nuit
Ensevelis sous un voile de peine
Dorment les hommes
Les femmes
Les enfants
Leurs sacs fatigués
Posés à même
La cendre des chemins
La nuit leur est un refuge
Où chuchote la terre d’ici
Et chacun s’allonge
Dans l’ombre du jour d’avant
Quand s’éteignent les heures
S’avive la mémoire
On rejoint l’envolée
Des oiseaux des lagunes
Les diagonales tressées
D’un bout du ciel à l’autre
Sur le seuil des cabanes
Veillent les chiens jaunes
Grandes bêtes à moitié sauvages
Dévoreuses de poussière
Leurs yeux à jamais ouverts
Dans la crainte du sommeil
Là où tombe la lumière
Dans l’abri des bosquets
On pose la main dans le creux
Des herbes froissées
Oublié
J’ai oublié le nom des fleurs
Qui nous dessinaient un jardin
Autour la plaine s’ensommeillait
Comme la mer le long des dunes
Le vent y creusait mille vagues
À la surface molle des blés
Sur une île nous habitions
Que reste-t-il du fracas
Des galets gris que les marées
Roulaient longtemps dans leur grand sac
Une pleine vie à les user
Sans fin les uns contre les autres
Et jusqu’à l’intime douceur
J’ai tout oublié de ce bruit
Ce bourdonnement qui brouillait
Le teint pâle d’un ciel aveugle
Ici le jour s’amenuisait
L’ombre venait sous le couvert
Des branches basses du tilleul
Tout bruissait désormais du vol
Des abeilles étincelantes
Pareilles à des langues de feu
Dans la vibrante multitude
J’ai oublié les cris des bêtes
Les oies les vaches les chevaux
Les chiens avec leurs yeux qui pleurent
Et pourquoi tout ce vacarme
Dans la fatigue d’un jour d’été
Loin dans la plaine les hommes fauchaient
J’ai oublié tous ces instants
Arrêtés sur la pente douce
Qui mène d’un crépuscule à l’autre
Et les noms des enfants qui sont
Comme des libellules affolées
À la surface de la nuit
Qu’un vent échappé des ornières
Dispersera dans le lointain
Avec les graines de chiendent
Je ne connais plus le secret
Des blancs couloirs qui nous menaient
De bord en bord jusqu’à ces chambres
Que la lumière a délaissées
Si je garde les yeux ouverts
Je verrai les oiseaux nombreux
Qui s’envolent et qui s’enfuient loin
Tout est sens dessus dessous tout
Il pleut
Ce matin il pleut
Le héron est au bord du fleuve
Indifférent à ce qui passe
Indifférent à tout
Le fleuve suit son cours
De toute éternité
Ce matin il pleut
Mais le héron s’en fout
Les pieds dans l’eau
Il est debout contre la pluie
On dirait une pierre
Une pierre couleur de cendre
Une pierre qui bientôt
Roulera dans le fleuve
Qui tous nous emporte
On dirait une pierre
Une pierre qui va mourir
À l’horizon
À l’horizon de cette nuit
Passent encore passent sans fin
De longs wagons couleur d’ombre
Couleur de pluie et puis s’en vont
Dans la déroute des lueurs
Là plus de chien pas même un loup
Nul ne pourra changer le cours
Ainsi ainsi va notre peur
Rideaux tirés sur la pagaille
Des jours laissés en contrebas
Le long convoi borde les rues
Tout encombrées de maisons basses
Pauvres jardins mangés de rouille
Haies qui s’écroulent sous le poids
De nos silences lourds comme pierre
À quai des hommes sans couleurs
Les bras chargés de souvenirs
Attendent et c’est depuis longtemps
Après le talus on devine
Dans l’herbe sèche le creux tiède
Où firent litière les amants
Leurs corps noués dans le matin
Haleine chaude au ras du ciel
Ils ont pris le chemin d’hiver
Celui qui longe notre oubli
Celui qui mène aux peupliers
Et dans l’abri secret des branches
Les oiseaux ferment les paupières
J’ai laissé tellement de nuits
La cendre à la peau d’une femme